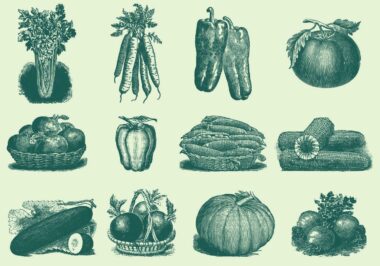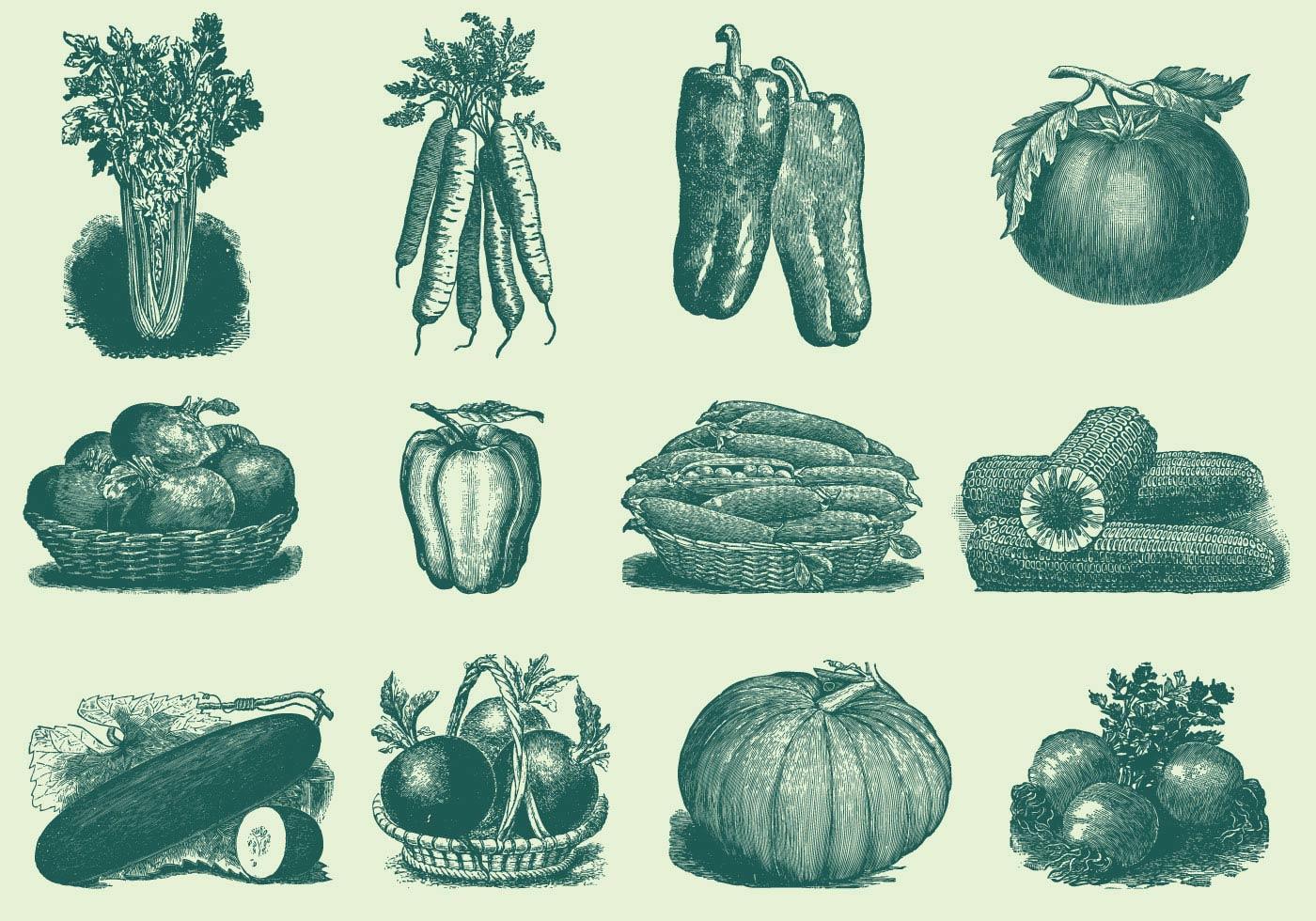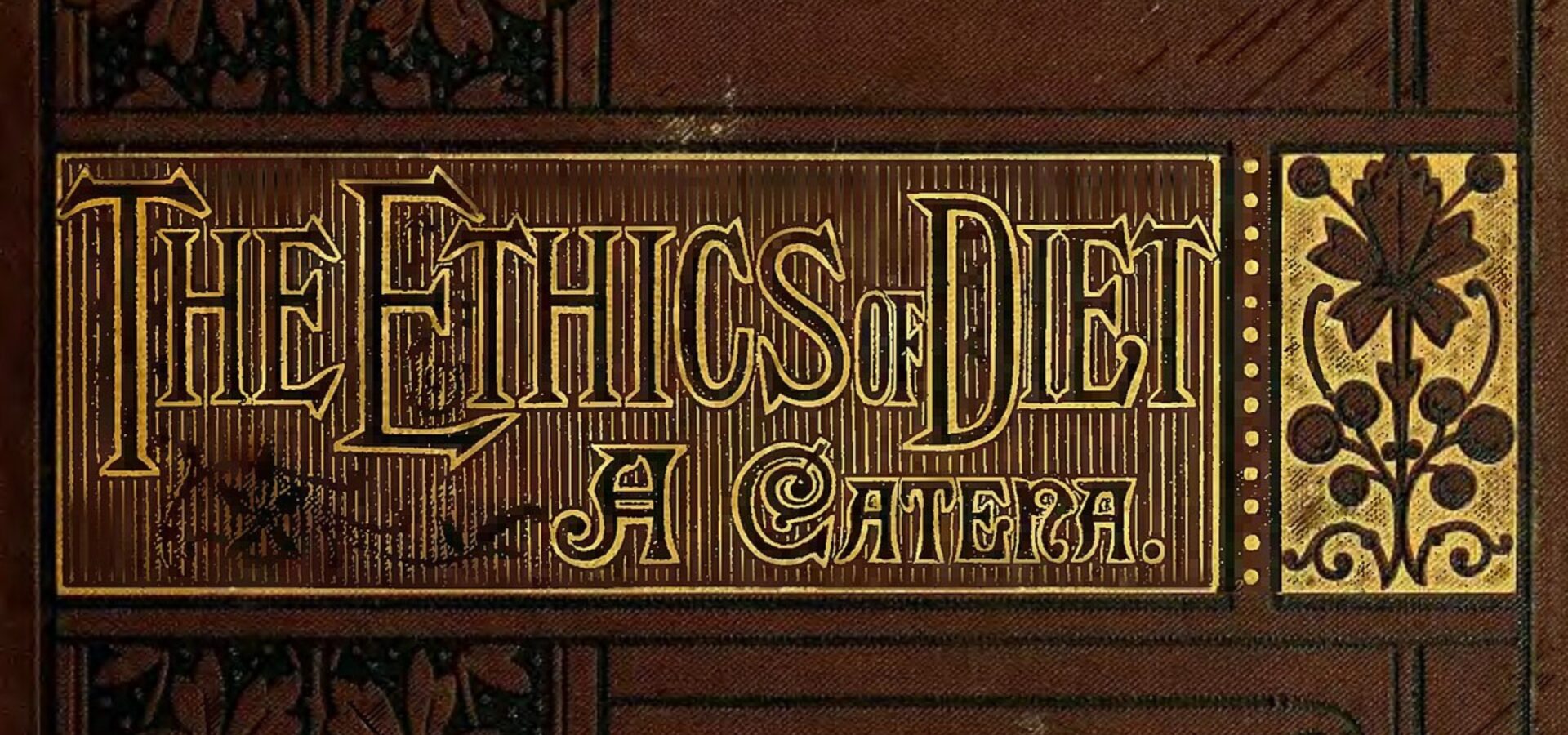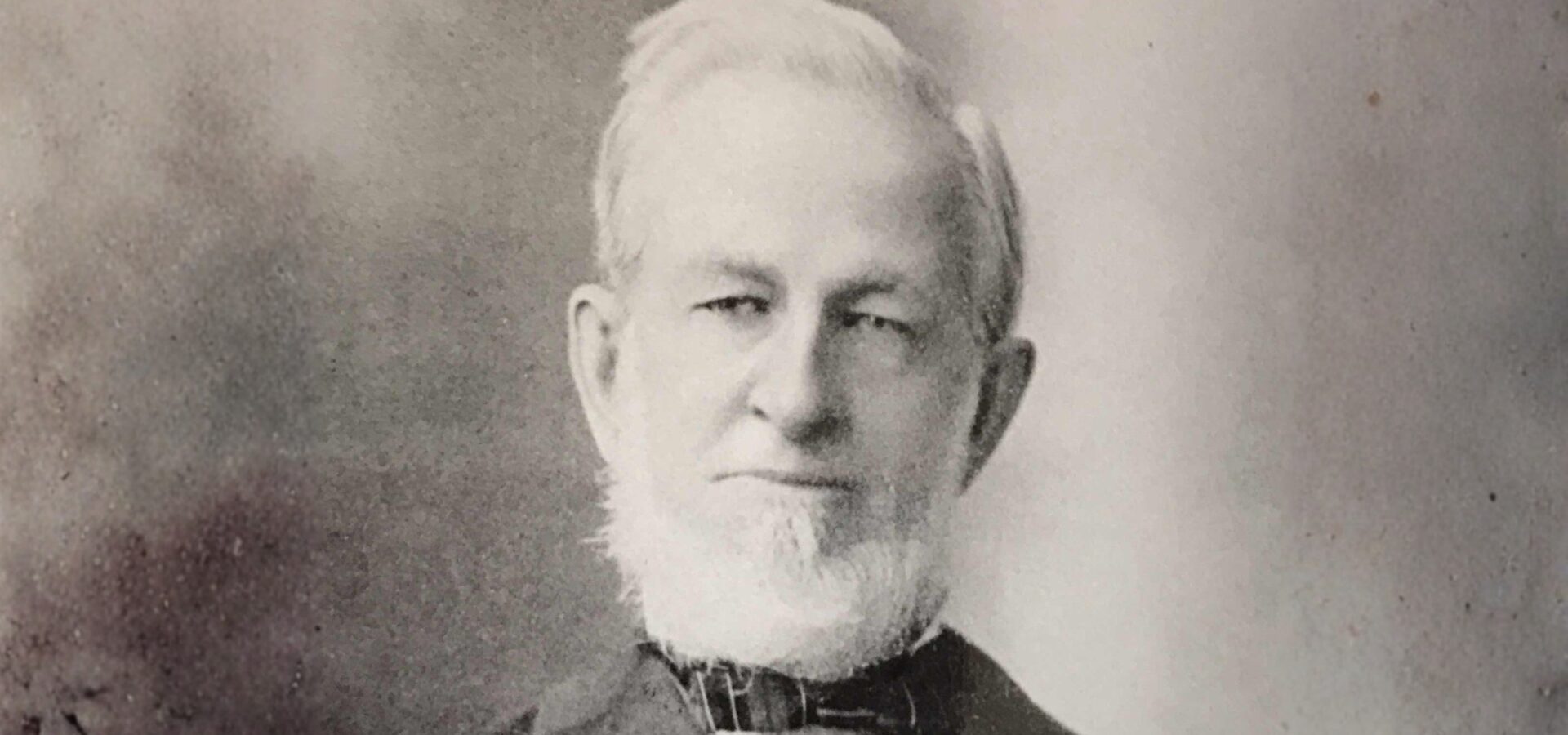Première structure végétarienne d’envergure nationale du pays, la Société végétarienne de France militait en faveur de la démocratisation du végétarisme et du végétalisme pour des raisons sanitaires, environnementales et de protection animale.
Création
À la fin du 19e siècle, le mouvement végétarien commence tout juste à se structurer en France. La première association végétarienne avait été créé à la fin des années 1870 par Thomas Richardson à Nice et rassemblait plusieurs médecins qui mettaient en avant les bénéfices pour la santé d’une végétalisation de son alimentation 1. En 1880, un autre médecin, Abel Hureau de Villeneuve, fonde la Société Végétarienne de Paris 23 et publie, en avril, le premier numéro de la revue La Réforme Alimentaire 4.
En 1882, la Société Végétarienne de Paris est dissoute et relancée sous le nom de Société Végétarienne de France dans le but de « propager le végétarisme et de faire valoir les avantages de tout ordre qu’il présente » 5. Deux médecins, le Dr. Goyard et le Dr. Aderboldt, en assurent respectivement la présidence et l’exécutif.
Développement
En 1906, la Société végétarienne de France compte 800 membres et oriente ses actions vers le grand public avec l’organisation de conférences et la diffusion de revues, de tracts et de brochures. En 1909, la Société déclare compter 1175 membres. La revue La Réforme Alimentaire est publiée jusqu’en 1914 6, bientôt remplacée par le Bulletin de la Société végétarienne de France édité de 1916 à 1920.
La Société végétarienne de France décline ensuite progressivement, mais d’autres groupes de réforme alimentaire favorables au végétarisme (et au végétalisme) continueront à diffuser une importante production intellectuelle, à commencer par les anarchistes.
Anarchisme
En effet, particularité française, le végétarisme n’est à l’époque pas seulement lié au mouvement de tempérance 7 ou a des considérations médicales, mais également à l’anarchisme 8. C’est d’ailleurs dans La Réforme Alimentaire que le militant et théoricien anarchiste Elisée Reclus publie, en 1901, sa tribune Le Végétarisme dans laquelle il présente l’élevage comme inhumain et son abolition comme une conséquence logique de notre évolution.
Emmené par Émile Gravelle, le mouvement anarchiste libertaire « naturien » de la fin du 19e et du début du 20e siècle critiquait la société, son industrialisation, son urbanisation, etc. et prônait le retour à une vie naturelle non pervertie 9. En plus de contribuer à poser les bases de la décroissance, certains naturiens (dont Georges Butaud, sa compagne Sophia Zaïkowska 10, Louis Rimbault et Henry Le Fèvre) prirent également position contre l’alimentation carnée et le sort fait aux animaux, prônant le végétarisme comme base de la réforme de la société.
Si Émile Gravelle pouvait considérer le végétarisme comme un « excès de sensibilité à propos de la souffrance provoquée par la mort brutale des animaux », Georges Butaud affirmait que le végétalisme est « la grande transformation qui rénovera le monde et que c’est d’elle seule que l’on peut attendre les [autres] transformations rêvées » 11. Diverses revues de sensibilité naturienne ont publié des articles traitant du végétarisme : Le Végétalien, Le Néovégétalien, L’État naturel, La Nouvelle humanité, La Vie naturelle, Le Flambeau, Le Néo-naturien, Le Naturien, etc. Même l’organe officiel de l’Union Anarchiste, Le Libertaire, a ouvert ses pages à des débats sur le sujet 12.
Notes et références
- International Vegetarian Union (IVU), History of the French Vegetarian Societies.
- Ceri Crossley, Consumable Metaphors: Attitudes towards Animals and Vegetarianism in Nineteenth-Century France, 2005, Peter Lang, pp. 241-243, ISBN 9783039101900.
- Margaret. Puskar-Pasewicz, Cultural Encyclopedia of Vegetarianism, 2010, Greenwood Publishing Group, p. 108, ISBN 9780313375569.
- BnF Data, Société végétarienne de France.
- BnF Data, Société végétarienne de France.
- Alexander Fenton, Order and Disorder: The Health Implications of Eating and Drinking in the Nineteenth and Twentieth Centuries, 2000, Tuckwell Press, pp. 209-226, ISBN 9781862321175.
- La tempérance désignait un important mouvement social-religieux du 19e et du début du 20e siècle. Initialement porté par les églises réformées, puis repris par l’Église catholique, ce mouvement luttait contre la consommation d’alcool. Les revendications portaient d’abord sur la diminution de la consommation, mais elles évoluèrent jusqu’à exiger l’abstinence totale, ce qui débouchera dans certains pays sur des politiques de prohibition.
- Association Végétarienne de France, Les Cahiers, Cahier N° 2, Éléments d’histoire du végétarisme en France, 2008.
- Revues Sauvages, Redécouvrir le « sauvage » à la fin du XIXe siècle. L’expérience des anarchistes naturiens, 2020.
- Dans Le Végétalien n° 8 de juin-juillet 1925, Sophia Zaïkowska et Georges Butaud mobilisent déjà l’idée de viser le bien-être de toute la communauté des êtres sensibles (« toute bête a son instinct, et l’homme a son génie, qu’il doit utiliser pour son propre bien, conforme à celui de son espèce et des autres êtres sensibles »). Dans l’Encyclopédie Anarchiste, dirigée par Sébastien Faure et publiée en 1934, Sophia Zaïkowska rédige l’article « Végétalisme », où elle revient sur le fait que plus on mène une vie simple, plus on est libre, et donc plus fort face à l’oppression.
- Georges Butaud, Avant-propos, Le Végétalien, n°9, 1927.
- Association Végétarienne de France, Les Cahiers, Cahier N° 2, Éléments d’histoire du végétarisme en France, 2008.