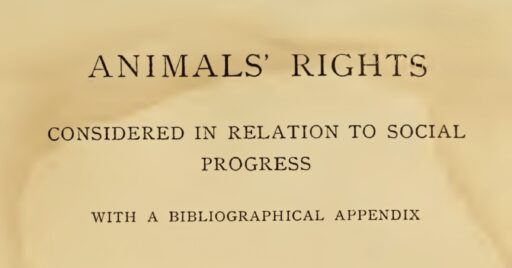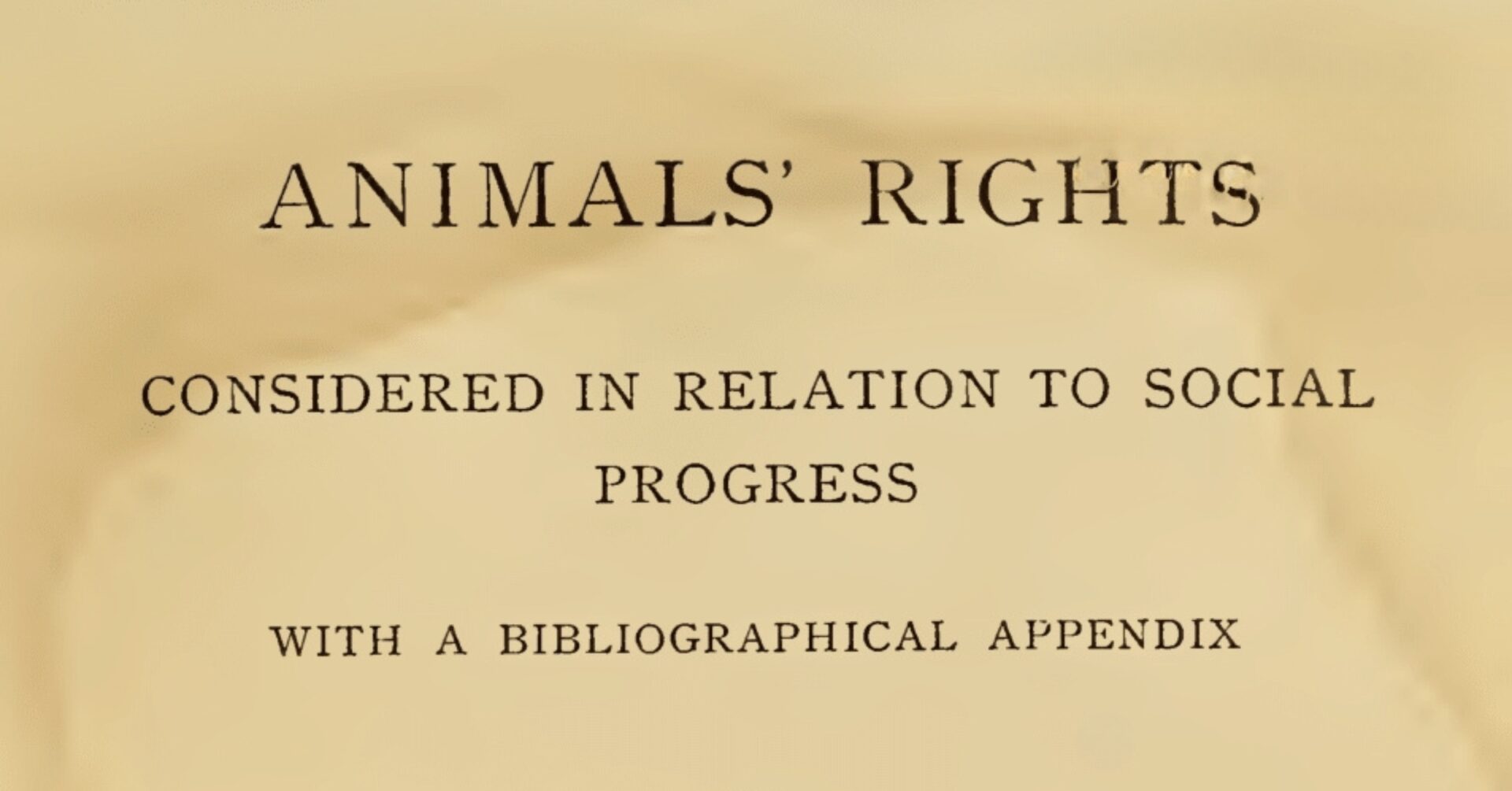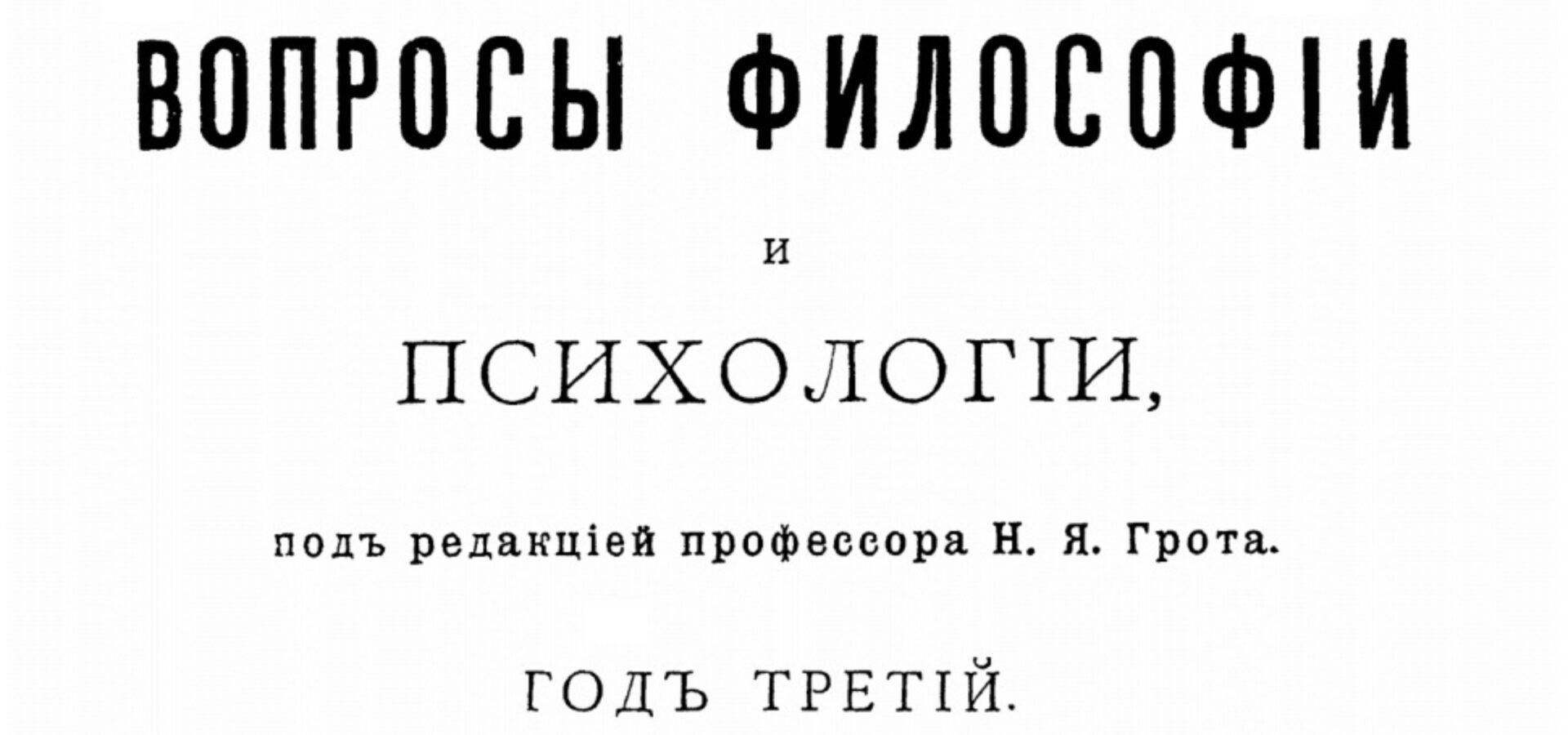Henry Stephens Salt était un écrivain anglais, socialiste et pacifiste engagé. Il milita toute sa vie pour que l’amélioration de la condition animale fasse partie intégrante des avancées sociales. Son ouvrage majeur est le premier dédié aux droits des animaux.
Un ouvrage pionnier
Henry Stephens Salt était un naturaliste et écrivain anglais réputé. Socialiste et pacifiste engagé, il milita toute sa vie pour davantage de justice sociale, aussi bien pour les humains que pour les animaux. Paru en 1892 1, son ouvrage « Animals’ Rights: Considered in Relation to Social Progress » (Les Droits de l’animal considérés dans leur rapport avec le progrès social) est considéré comme le premier livre consacré aux droits des animaux.
Salt y défend l’idée qu’il n’existe pas de différence de fond entre les humains et les animaux, et qu’il est impossible d’ériger entre eux une frontière absolue avec d’un côté des personnes et, de l’autre, de simples choses. Ne négligeant aucune forme de cruauté, il désigne toutefois l’alimentation carnée comme la plus meurtrière des exploitations.
Selon lui, c’est l’absence de droits pour les protéger qui entraîne inévitablement la dépréciation des animaux au rang d’objets inanimés et insensibles, soumis à d’innombrables sévices.
Les animaux ont-ils des droits ? Sans aucun doute, si les hommes en ont.
Henry Stephens Salt, Les Droits de l’animal considérés dans leur rapport avec le progrès social, 1892
À la portée philosophique et pratique
Pour sortir de ce système de domination des humains sur les animaux et dépasser la simple question du bien-être animal, trop souvent dévoyée, Salt entreprend de décrire ce que devraient être ces « droits des animaux » pour les protéger des multiples pratiques humaines dont ils sont victimes.
Il aborde ainsi de nombreuses questions liées à l’exploitation animale telle que l’alimentation carnée, la chasse, la fourrure et la vivisection. Il dénonce également l’incohérence des philosophes « moralistes » qui, tout en rejetant l’idée d’ « animal-machine » dénué de sensibilité et en fondant leurs théories morales sur la compassion, continuent malgré tout à consommer des animaux.
Soucieux de protéger les animaux de potentielles dérives, notamment dans le domaine de l’expérimentation animale, Salt défend un utilitarisme dit « négatif », qui donne la priorité à la réduction de la souffrance plutôt qu’à l’augmentation du bonheur. Selon lui, une activité procurant un grand plaisir au prix d’une faible souffrance imposée à un autre être sensible reste condamnable car le bénéfice, bien que plus important, ne saurait justifier la souffrance causée.
Visionnaire sur de nombreux aspects, l’ouvrage se finit sur ces mots :
Pour conclure, je déclarerai énergiquement que cet essai n’est pas un appel ad misericordiam à ceux qui agissent ou qui excusent les autres d’agir comme nous le leur reprochons ici. Ce n’est pas un appel à la pitié (loin de là !) en faveur des « bêtes », dont le seul crime consiste à ne pas appartenir à la noble famille de l’homo sapiens ; c’est plutôt une adresse à ceux qui voient et qui sentent que, comme on l’a si bien dit, « le grand mouvement progressif du monde à travers les âges se mesure au développement de la bonté et l’affaiblissement de la cruauté », que l’homme, pour être vraiment homme, doit cesser de nier ses liens avec tout ce qui vit dans la nature, et que la prochaine réalisation des droits de l’homme aura pour suite la plus tardive mais non moins certaine la réalisation des droits de l’animal.
Henry Stephens Salt, Les Droits de l’animal considérés dans leur rapport avec le progrès social, 1892
Consulter la première édition américaine publiée en 1894.
Consulter la première traduction française parue en 1900.
Notes et références
- Henry Stephens Salt, Animals’ Rights, Considered in Relation to Social Progress.