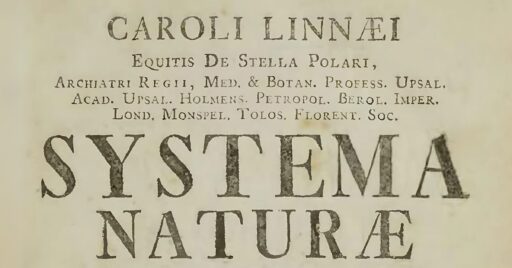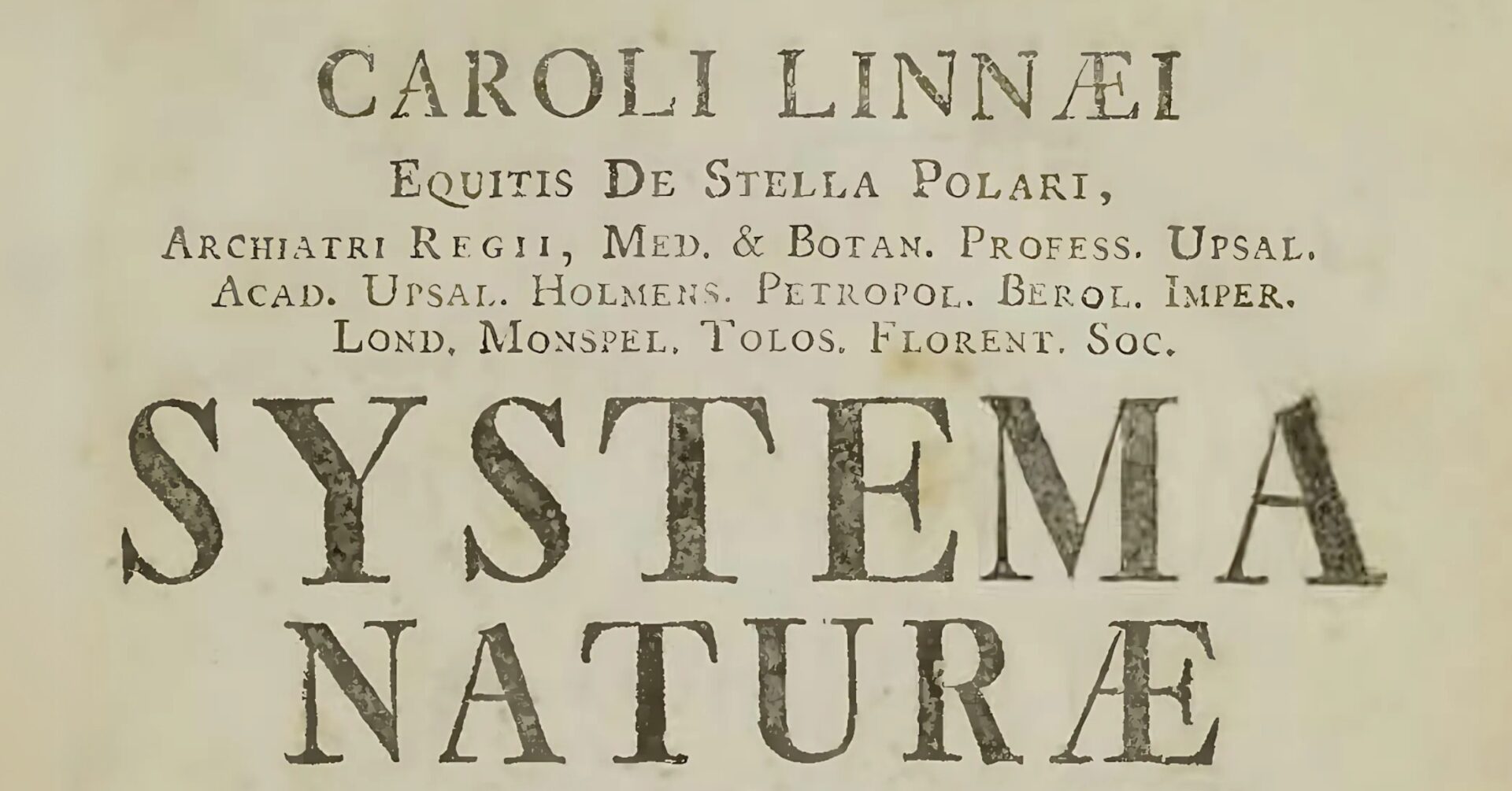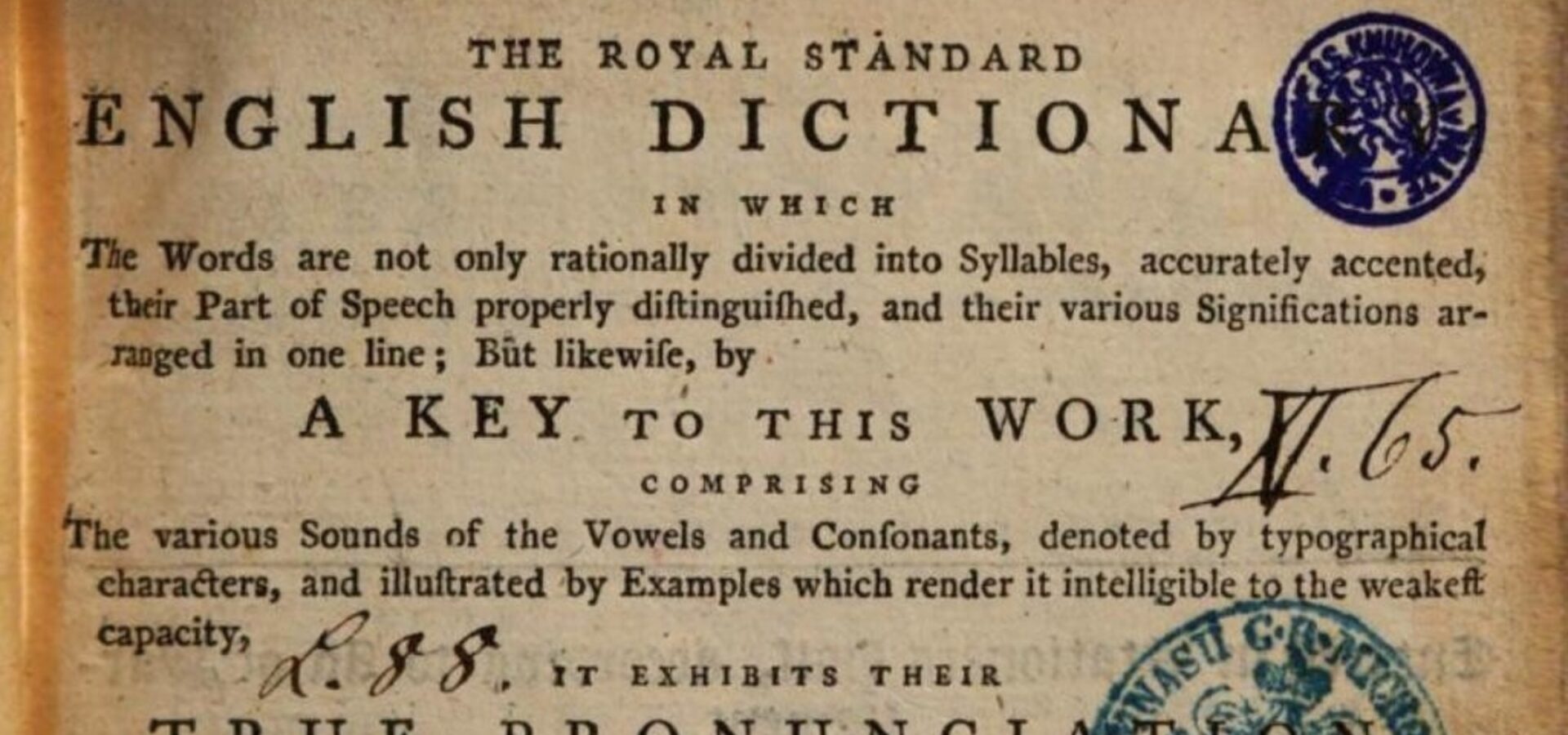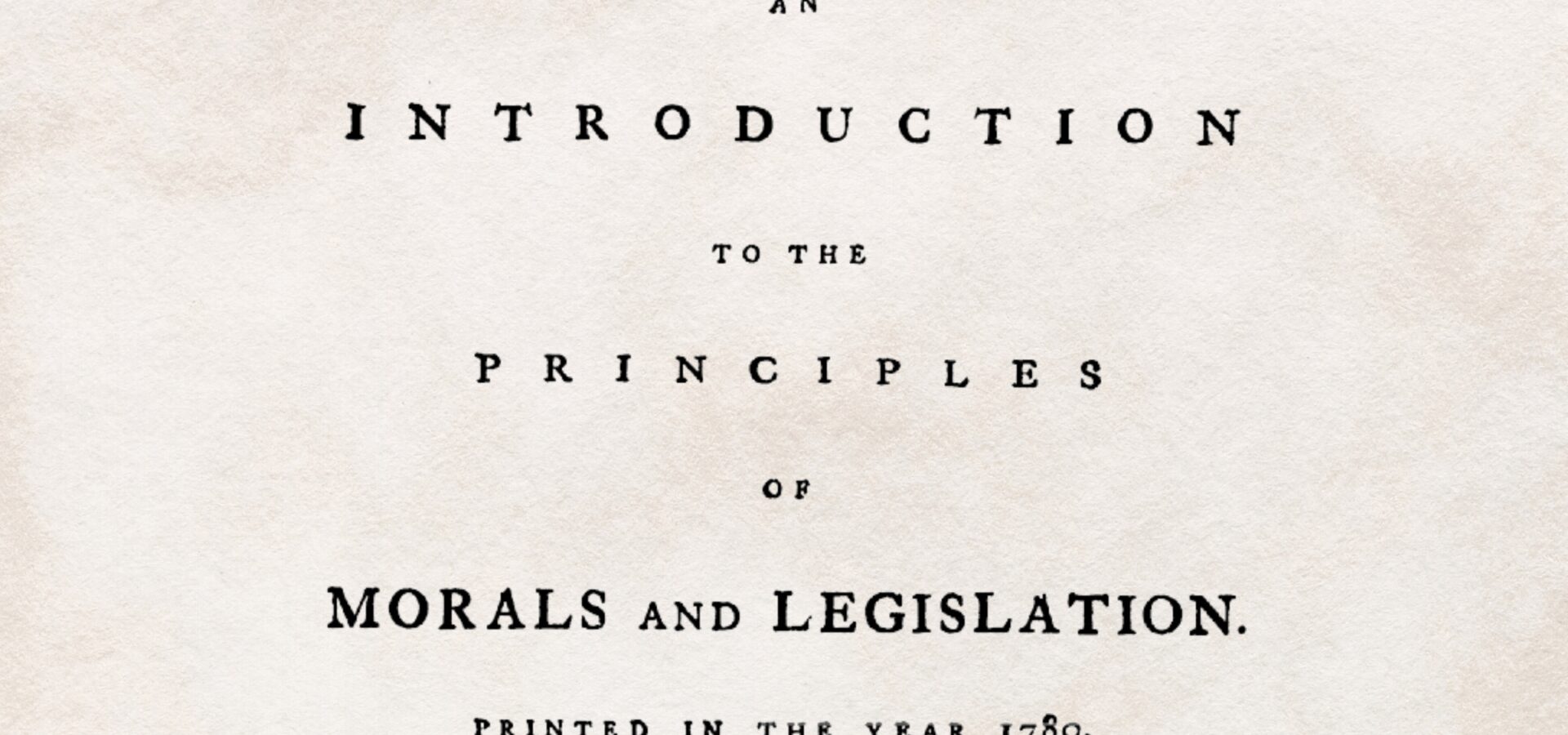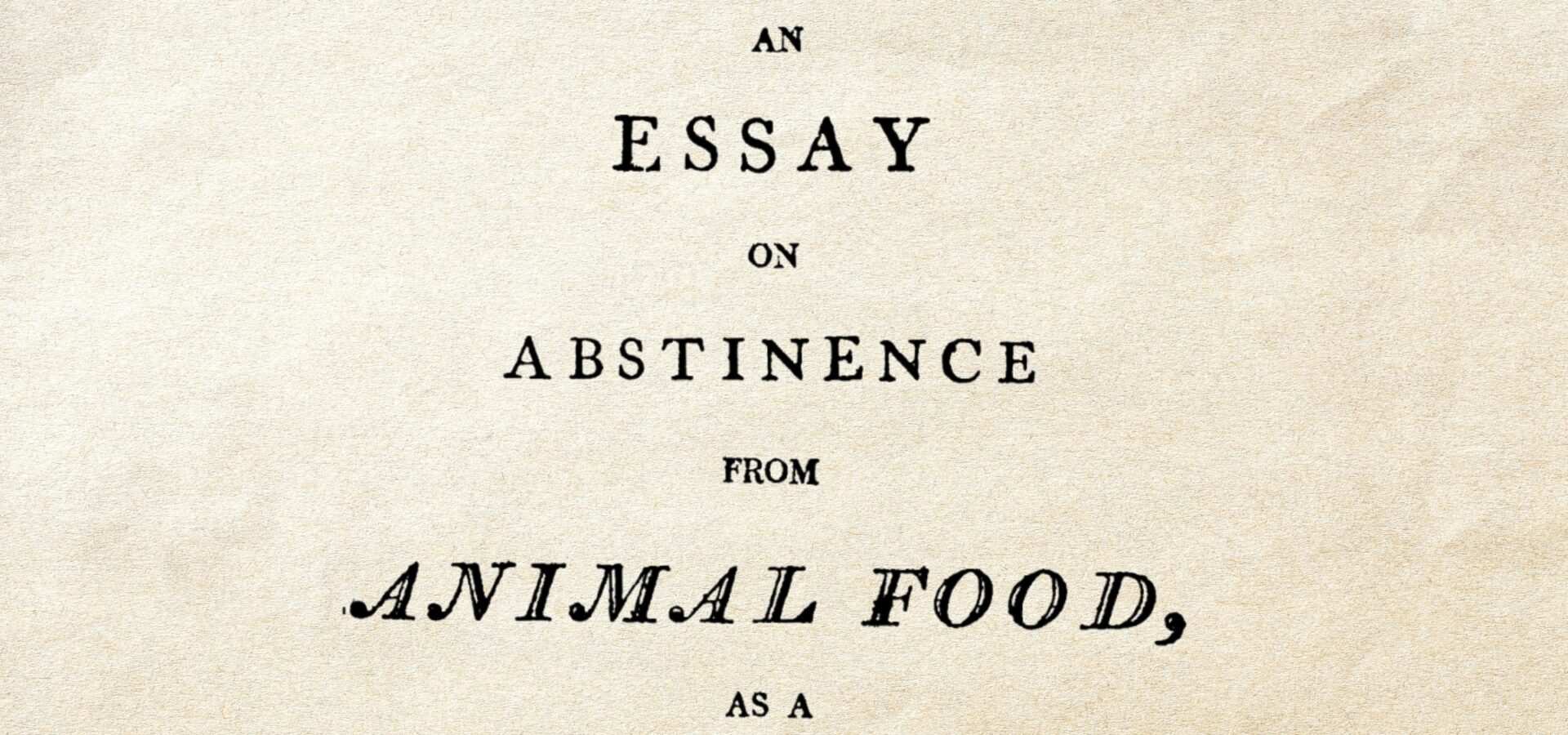Le naturaliste Linné observe que tous les êtres vivants présentent certaines similitudes anatomiques. Il classe alors pour la première fois les humains au sein de l’ordre des Primates, posant les bases de la reconnaissance de leurs liens de parenté.
La classification de Linné
Carl Linnæus (1707 – 1778), connu sous le nom de Carl von Linné 1, est un naturaliste suédois dont les travaux ont marqué une étape décisive dans l’histoire des sciences naturelles en systématisant et en popularisant la nomenclature binominale, dans laquelle chaque espèce se voit attribuer un genre et d’un épithète spécifique (« Homo sapiens » pour l’humain, « Canis lupus » pour le loup, etc.). Depuis Linné, cette terminologie est devenue le langage commun de la biologie et constitue aujourd’hui la norme universellement acceptée pour la classification des êtres vivants.
Bien que Linné ait d’abord exposé sa méthode dans la première édition de « Systema naturæ » (Système de la nature) 2, un opuscule de 11 pages rédigé en latin qui paraît à Leyde aux Pays-Bas en 1735, c’est avec la dixième édition 3, publiée en deux volumes en 1758 et 1759 à Stockholm, que commence véritablement l’histoire naturelle de l’Homme.
Les humains parmi les primates
Après les plantes dans sa publication « Species Plantarum » en 1753 4, Linné y systématise, avec l’aide de son réseau de correspondants, la première classification scientifique du vivant ; répertoriant, nommant et classant l’essentiel des espèces connues à son époque. 5. Les espèces animales sont alors réparties en six grandes classes : quadrupèdes, oiseaux, amphibiens, poissons, insectes et vers, chacune d’entre elles étant déterminée par des caractères anatomiques spécifiques comme les dents, les becs, les nageoires ou les ailes.
L’un des éléments les plus significatifs du travail de Linné est la classification de l’espèce humaine 6 qui se distingue ici des grands singes (Homo sylvestris) par des caractéristiques psychologiques et sociologiques plutôt que corporelles. Selon l’ordre anatomique, observe Linné, tous les êtres vivants ont, à des degrés divers, des structures communes et un fonctionnement commun.
Acte déterminant pour son époque, Linné classe l’humain (genre Homo) parmi les mammifères, en raison de ses mamelles, et au sein de l’ordre des Primates, sur la base de sa dentition, le rapprochant ainsi des singes (genre Simia), des lémuriens (genre Lemur) et même des chauves-souris (genre Vespertilio) 7. Bien que l’espèce humaine constitue un genre à part entière, Homo, qui ne comprend qu’une seule espèce, Homo sapiens, cette classification marque la reconnaissance des liens de parenté entre l’humain et les autres primates, une idée qui scandalise une partie de ses contemporains.
Une évolution commune
Cette proximité anatomique n’était toutefois pas entièrement nouvelle. Dès l’Antiquité, le médecin Galien (environ 130-200 de notre ère) avait fondé son modèle d’anatomie humaine sur les dissections de macaques. Toutefois, à cette époque, cette proximité anatomique était interprétée comme une simple ressemblance et non comme le signe d’une véritable parenté. La frontière entre l’homme et l’animal était donc encore très marquée, tant chez les penseurs religieux que non religieux, qui cherchaient à préserver une vision dualiste et hiérarchisée du monde vivant 8.
Au cours du 18e siècle, les premières idées évolutionnistes commencent à émerger et les ressemblances anatomiques entre les humains et les autres primates sont progressivement perçues comme les preuves de l’appartenance commune à une même famille animale, liée par des générations successives. Assez curieusement, à mesure que la théorie de l’évolution se développe au 19e siècle et qu’une vraie parenté s’affirme entre le singe et l’humain, la taxonomie tend à les éloigner à nouveau. Ainsi, tandis que Linné avait inclus l’Homme dans l’ordre des Primates, le naturaliste Georges Cuvier choisira en 1816 de le placer dans un ordre à part, celui des Bimanes, tandis que les singes restent dans l’ordre des Quadrumanes 9.
Quelques décennies plus tard, en 1859, Charles Darwin viendra confirmer notre parenté commune avec la théorie de l’évolution par sélection naturelle, remettant en cause les conceptions traditionnelles sur l’existence d’un « propre de l’Homme ».
Consulter le premier volume de la dixième édition de « Systema naturæ » de Carl von Linné.
Notes et références
- En 1761, Carl Linnæus est déjà célèbre mondialement et est le médecin officiel de la famille royale de Suède. Il est anobli et prend en 1762 le nom de « Carl von Linné », Linné étant un diminutif de Linnæus « à la française » selon la mode de l’époque et « von » étant la particule nobiliaire germanique.
- Carl von Linné, « Systema naturæ, sive regna tria naturæ systematice proposita per classes, ordines, genera, & species », en français « Système de la nature, ou les trois règnes de la nature sont divisés systématiquement en classes, ordres, genres et espèces », 1735, voir en PDF.
- Carl von Linné, « Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis », en français « Système de la nature, en trois règnes de la Nature, divisés en classes, ordres, genres et espèces, avec les caractères, les différences, les synonymes et les localisations », voir en PDF.
- Carl von Linné, « Species Plantarum », 1753, Voir en PDF.
- Jusqu’à la parution du troisième volume de la 13e édition en 1793, cette classification sera constamment revue et augmentée.
- La classification de Linné a très mal vieillie sur certains points, comme sur la division d’Homo sapiens en six variétés : quatre, sur la base de la couleur de la peau (le blanc européen, le rouge américain, le jaune asiatique et le noir africain) à laquelle correspondent des différences dans les mœurs, dans les tempéraments (la colère, la mélancolie, etc.) et dans les principes qui les guident (l’habitude, les rites, les opinions, etc.) ; l’Homo ferus, à savoir les enfants sauvages retrouvés à différents moments dans les bois européens, et l’Homo monstruosus dont la condition découle de la nature (les géants, les nains, etc.) ou de l’art, comme les Hottentots ou les femmes européennes soumises aux corsets.
- Linnæus, C. 1758. Systema naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Tomus I. Editio decima, reformata. – pp. [1–4], 1–824. Holmiæ. (Salvius), p. 18.
- Les travaux de Linné étaient fondés sur des certitudes religieuses immuables : fixité des espèces, nombre fini de créations divines, etc.
- Georges Cuvier, « Le règne animal : distribué d’après son organisation, pour servir de base à l’histoire naturelle des animaux, et d’introduction a l’anatomie comparée », op. cit., vol. 1, p. 81-82, 1816.